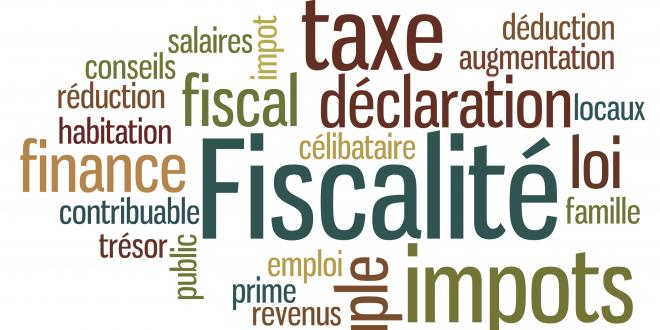Le LaboNFC a contribué à faire du 86ème congrè annuel de l’ACFAS à Saguenay, un événement mémorable. Le colloque organisé par les membres réguliers du LaboNFC a par ailleurs obtenu la mention « Coup de Coeur » de l’ACFAS.
Annoncé à l’avance par ses membres dans une tribune du Quotidien, le colloque organisé par le LaboNFC, en date du 8 mai, a réuni des chercheurs du Canada et d’outre-mer, notamment de France (EDHEC Business School, Université de Rouen, et Université de Bretagne Occidentale), afin d’échanger sur la thématique clé de la reconfiguration des échanges marchands.
Après une brève introduction sur les fondements de ce colloque, les présentations et discussions se sont déroulées dans le cadre de quatre thématiques majeures:
L’impact des nouvelles technologies
Nulle doute que les technologies ont joué un rôle prépondérant dans l’émergence de nouvelles formes de consommation. Deux interventions définirent plus concrètement cet impact. La première réconcilie développement technologique et conscience environnementale. En effet, Sébastien Leblanc-Proulx et coll. arrimèrent les évolutions technologies aux capacités d’extension de la durée de vie des objets. L’étudiant, membre du LaboNFC, présenta ainsi une taxonomie originale de modèle d’affaires allongeant la durée de vie des objets selon des configurations d’échanges inédites ou réinventées (ex. reconditionnement, les systèmes de logistiques inversées, les plateformes électroniques d’accès et de redistribution, la maintenance et la réparation). Si les fabricants de biens sont souvent accusés de raccourcir volontairement la durée de vie des objets par l’obsolescence programmée, la taxonomie met en lumière la manière dont l’échange – notamment ses formes les plus élaborées – et la collaboration allongent la durée de vie des objets. Si les problématiques de production sous-optimale demeure, l’exposé a le mérite de mettre en lumière des systèmes permettant de contrevenir, souvent involontairement, à la triade non-durable « produire – consommer – jeter ». Cliquer ici pour voir la présentation.
Les échanges peuvent prendre de multiples formes, c’est ce que nous enseigne le marketing. Anne-Françoise Audrain-Pontevia (ÉSG-UQAM) et Loick Menvielle (EDHEC Business School) nous rappelle ceci en nous amenant sur le terrain de la technologie dans le domaine médical. Le croisement entre santé et technologie est d’autant plus importante dans un contexte de vieillissement de la population où le rapport à la santé et aux services sociaux sera de plus en plus crucial, ainsi que dans un contexte de changement technologique radical dans le domaine de la santé tel qu’au travers de l’Internet des Objets (ex. lits connectés). Ils rapportent ainsi la manière dont les communautés de patients en ligne modifient la relation qu’ont les patients avec leurs médecins. Leurs résultats suggèrent qu’une fréquentation accrue de ces plateformes améliorerait le sentiment d’empouvoirement des patients atteints de maladies chroniques. Cela se traduirait par un plus grand engagement et une plus grande implication dans leur relation avec le médecin. Ainsi, si les patients en savent plus, ce n’est pas forcément au détriment de leur relation avec le médecin, lequel demeure une référence. Au contraire, les échanges sont plus riches car les patients sont mieux informés. Les réflexions peuvent être transposés à d’autres domaines où le numérique prend une importance croissante, tel que l’enseignement par exemple, notamment en milieu collégial et universitaire.
Les comparaisons intersectorielles
Une partie importante des échanges a trait aux produits de consommation courante, en particulier la nourriture. La professeure Francine Rodier (ÉSG-UQÀM) nous démontre ainsi à travers de multiples exemples très bien référencés comment les individus réorganisent les systèmes d’accès aux produits de base nécessaires à toute survie humaine. En France, par exemple, les AMAPs (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) permettent aux individus de se fournir directement auprès des producteurs locaux sans intermédiaires, voire de s’impliquer dans les décisions relatives à la culture et le conditionnement des produits. Cela n’est pas sans rappeler les divers mouvements locavores qui se développent en Amérique du Nord ainsi que les systèmes de boîtes de fruits et légumes ou de repas envoyés à domicile par les producteurs eux-mêmes. Conscients des potentiels de croissance de ce marché, fabricants et détaillants eux-mêmes ont développé des formules de « box » à domicile. La reconfiguration des échanges marchand dans le domaine alimentaire s’articule donc autour de l’idée prégnante du mieux manger pour mieux vivre. Que ce soit par les labels et produits équitables, biologiques, éthiques, locaux, citoyens, responsables, ou verts, le dumpster diving (déchettivore), l’agriculture urbaine, ou les systèmes de retour d’aliments chez les détaillants, les échanges alimentaires se veulent de plus en plus pratiques mais surtout plus sensés (ayant plus de sens). Outre les labels religieux (halal, casher…), la quête de sens « sécularisée » dans la consommation alimentaire est un aspect qui s’amplifie. Cette thématique reviendra par ailleurs assez souvent au cours du colloque.
Fiscalité, régulation et rôle de l’État dans les nouvelles formes d’échange marchand
Les remous médiatiques et juridiques de plusieurs « pontes » de l’économie collaborative, particulièrement Uber au Québec mais aussi Airbnb, ont fait couler beaucoup d’encre, polarisé le débat social, pour finalement amener à une normalisation graduelle de ces plateformes. Le professeur Fabien Durif (ÉSG-UQÀM), directeur de l’Observatoire de la Consommation Responsable (OCR) et du GreenUXLab, évoqua plus en détail les problématiques liées à cette normalisation. Au Québec, actuellement un groupe de travail se penche sur les possibilités d’intégrer les plateformes et applications collaboratives dans le cadre de la loi. Le rapport de consultation réalisé en collaboration avec Myriam Ertz, un des membres du LaboNFC, a d’ailleurs constitué une base solide pour entamer cette réflexion. Il fait notamment état de l’intensité de l’utilisation des diverses plateformes et pratiques collaboratives, et donc de leur importance relative. Le conférencier mit ainsi en lumière la perception des citoyens relatives à l’aspect éthique ou non éthique de ces plateformes. Le consensus, les normes et valeurs sociales déterminent souvent la législation subséquente. Pour l’heure, si les citoyens perçoivent les plateformes collaboratives dans une zone grise, sans nécessairement voir de problème éthique, un encadrement étatique leur semble toutefois désirable, notamment par un projet de loi, l’obligation de payer des taxes et l’adaptation des réglementations existantes. Selon le conférencier, c’est très vraisemblablement à cela que s’achemineront les recommandations à l’intention du gouvernement provincial voire fédéral.
Les développements théoriques liés aux reconfigurations de l’échange et de la consommation
Après des analyses par secteurs, par domaines ou par pratiques, très spécifiques, une réflexion plus fondamentale a été effectuée sur les aspects théoriques sous-tendant les reconfigurations de l’échange. On rapporte souvent que les nouvelles formes d’échange, si elles existent et qu’elles prospèrent, c’est parce qu’elles créent plus de valeur pour ses usagers. Mais de quel type de valeur au juste? Et comment mesure-t-on celle-ci? Le professeur Patrick Gabriel (Université de Bretagne Occidentale), directeur du Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest (LEGO), axe la réflexion sur ce concept assez élusif de la valeur. Si une certaine confusion existe autour de ce terme, ce serait parce qu’il n’y a pas une valeur mais plusieurs types de valeur créés lors d’un échange marchand (la valeur d’échange, la valeur expérientielle et la valeur en usage). De plus, ces types de valeur sont liés au cours de l’échange et sont différés dans le temps, dans le sens où elles apparaissent ou disparaissent, se maintiennent ou s’effacent, et ce, au-delà de l’instant d’échange pur. En somme, quand on réfléchit plus intensément sur ces notions de valeur, on peut se questionner sur la possibilité de les mesurer concrètement. On peut aussi s’interroger sur le point d’ancrage de l’analyse: doit-on s’intéresser à l’échange (moment d’interaction) ou au processus (la série d’échanges liés conduisant à une finalité ou un usage)? La notion de « parcours de valeurs » serait une piste de réponse à ces questionnement. Pour en savoir davantage : Cliquer ici.
Julien Bousquet (UQAC), membre du LaboNFC, et ses collègues, nous proposent une analyse historique d’un phénomène de consommation assez inédit, le pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. Les auteurs élaborent sur les notions de sacré et de profane, deux termes généralement opposés mais qui historiquement et conceptuellement sont liés, particulièrement dans le domaine de l’échange marchand. Le pèlerinage en est un exemple frappant. Si le pèlerinage est avant tout de l’ordre du sacré, il génère aussi des ressources colossales par les échanges marchands qu’il génère. Pensons au pèlerinage à la Mecque ou à St-Jacques de Compostelle. Si sacré et profane sont clairement inter-reliés, l’analyse historique a permis de faire ressortir plus finement 3 nuances de cette inter-relation:
1. Séparation: Au Moyen-Âge, la dichotomie est la plus vivace avec une séparation claire entre les deux.
2. Enchâssement: Lors de la Renaissance, il a un enchâssement des deux, et le marché est accolé au religieux de manière moins complexée.
3. Hybridation: L’ère postmoderne signe une hybridation entre une sacralité qui est de fait marchande car vidée de sa substance spirituelle primordiale, notamment par le biais de la sécularisation de la société, et une consommation marchande à l’origine profane mais qui se sacralise de plus en plus (ex. iconicité de la mode, idoles du divertissement, fanatisme sportif).
Pour en savoir plus: Cliquer ici. En définitive, hybridation sacré-profane de l’ère actuelle (dite postmoderne) rejoint l’idée d’une quête de sens nécessaire aux individus. Sans se situer dans le dogme et les valeurs du religieux, autrefois pourvoyeur de sens absolu et de transcendance, l’individu recherche ce sens dans de multiples aspects de sa vie. Dans le postmodernisme, la consommation est l’aspect central du projet de vie individuel et cimente la société. La recherche de sens s’effectue donc de manière privilégiée dans l’échange marchand. Le consommer juste, bon et bien, hybridation originale postmoderne, remplace le consommer tout court, d’une part ou le croire tout court, d’autre part.
La reconfiguration de l’échange et la remise en cause potentielle du modèle néolibéral
En prolongement à la réflexion théorique entourant l’échange marchand, une réflexion synthétique s’imposait. Présentée par le professeur Éric Rémy (Université de Rouen), celle-ci portait sur la probabilité que toutes ces formes d’échange nouvelles allaient ultimement amener à une remise en cause du modèle néolibéral. S’il est difficile de définir clairement le terme « néolibéral », il n’en demeure pas moins que ce concept a une résonne souvent négative car associé à la mondialisation débridée, à l’hyperconsommation (Lipovetsky, 2003), au capitalisme financier avide et aux méfaits économico-sociaux qui y sont rattachés. Le professeur Rémy réutilise la pensée des grands auteurs français tels que Mauss, Durkheim ou Bourdieu afin de nous éclairer sur la situation actuel et ses trajectoires d’évolution possibles pour le futur. Ainsi, le néolibéralisme ne serait pas réellement en danger face à l’émergence de nouvelles formes de consommation. À l’instar du capitalisme, qu’il porte en lui, il ne ferait que se réajuster aux nouvelles normes et systèmes d’échange:
tu veux du vert et de la consommation verte, je vais te donner des produits écologiques et verts et tu pourras les acheter, les consommer puis les recycler!
Cette capacité d’adaptation fait écho à plusieurs modalités d’échange nouvelles évoquées lors du colloque: la taxonomie des modèles d’affaire qui étendent la durée de vie des produits (ex. produits reconditionnés), les formes de valeurs en échange (ex. Patagonia et la valeur en fin de cycle du produit), la consommation de produits alimentaires biologiques ou locaux (ex. labels bios, appellations d’origine contrôlée), la consommation de religieux (ex. le pélerinage musulman ou catholique), ou la capitalisation des plateformes collaboratives (ex. Uber vaut 62,5 milliards USD vs. General Motors vaut 52,3 milliards USD). On peut également voir ceci dans l’assimilation progressive de la blockchain et des cryptomonnaies, à l’origine décentralisés et pairs-à-pairs, par les grandes organisations financières afin les centraliser et d’y exercer un contrôle.
La question ne serait donc pas dans quelle mesure les nouvelles formes d’échange remettraient en cause le modèle néo-libéral mais plutôt : comment le néolibéralisme persiste-t-il au travers de ces nouvelles formes d’échange marchand? Des réflexions plus critiques s’axeraient sur l’aspect désirable ou normatif de cette subsistance.